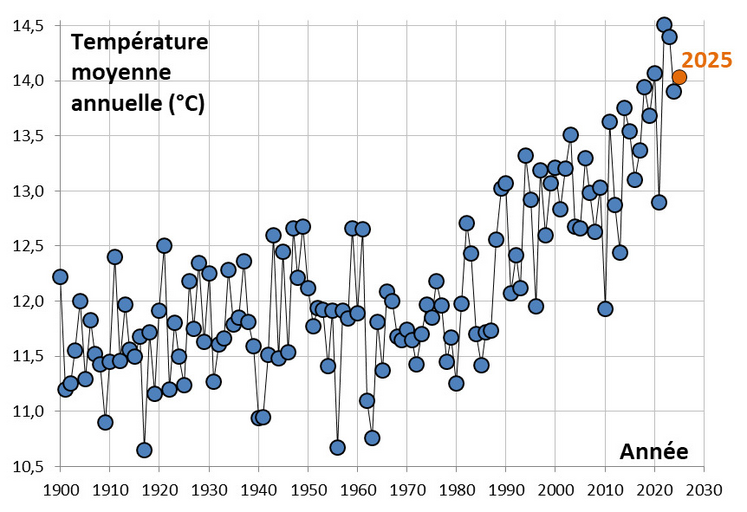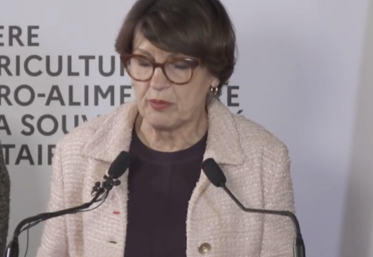Histoire locale
Sur les traces du cognac angérien
Le musée des Cordeliers de St-Jean-d’Angély propose jusqu’en septembre 2022 une exposition retraçant l’histoire de la production et du négoce de cognac dans la ville.
Le musée des Cordeliers de St-Jean-d’Angély propose jusqu’en septembre 2022 une exposition retraçant l’histoire de la production et du négoce de cognac dans la ville.

Audouin, de Reboul, Richard, Romée-Fleury… À St-Jean-d’Angély, tous ces noms étaient autrefois ceux de producteurs et négociants réputés de cognac. Il y en eut parfois jusqu’à vingt-cinq installés simultanément dans la ville des Vals de Saintonge. Alors qu’il ne reste aujourd’hui de ce patrimoine que les maisons Chabasse et Bouron, le musée des Cordeliers propose une rétrospective permettant de se plonger dans le riche passé viticole de la ville.
‘‘L’odyssée du cognac angérien’’ est née d’une rencontre, explique Brigitte Derbord, documentaliste-archiviste du musée. « Isabelle Combes, descendante de la famille Rogée-Fromy, voulait organiser une exposition, et elle souhaitait qu’y soient associées les autres maisons. » Au cours d’un long travail de préparation sur toute l’année 2019 et une bonne partie de l’année 2020, les équipes du musée parviennent à entrer en contact avec une quinzaine de descendants de négociants et viticulteurs angériens qui leur confient des pièces à exposer, tout comme les passionnés de l’Association pour le développement de l’animation au musée (Adam). Tout était prêt pour l’inauguration de l’exposition, en novembre dernier… Jusqu’à ce que la situation sanitaire s’en mêle.
Transporté sur la Boutonne
Malgré ce retard forcé à l’allumage, le public aura plus d’un an, jusqu’en septembre 2022, pour découvrir cette ‘‘odyssée’’. Elle permet de découvrir la longue histoire du cognac sur le territoire angérien, qui trouve ses racines dans le commerce des vins de St-Jean-d’Angély au Moyen-Âge : des crus réputés présents sur les grandes tables, assure Brigitte Derbord. Mais les guerres de Religion, jusqu’au siège dévastateur de la ville en mai-juin 1621, vont mettre à mal cette production. « La production de vin n’était plus aussi qualitative ensuite », explique la documentaliste. « Les vieux cépages étaient perdus. Mais Saint-Jean-d’Angély a ensuite pu se relever grâce au négoce du cognac. »
L'essor du cognac angérien connaît son apogée dans la seconde moitié du XIXème siècle... Juste avant la crise du phylloxéra.
La ville bénéficiait de ses anciens réseaux de commercialisation allant jusqu’en Europe du Nord, et d’un autre atout précieux : la Boutonne. Avant l’arrivée du train, les voies fluviales sont indispensables pour l’échange de marchandises. Les barriques expédiées depuis St-Jean-d’Angély descendent la rivière jusqu’à Tonnay-Charente, le grand port de la province de Saintonge, préféré à La Rochelle. « Ça évitait d’avoir une autre taxe à payer en entrant en Aunis », souligne Brigitte Derbord. Cet essor connaît son apogée dans la seconde moitié du XIXème siècle… Juste avant la crise du phylloxéra, débutée en 1875 dans les Charentes, qui sonnera le glas de cet âge d’or angérien du cognac. « Il a fallu dix ans pour trouver un remède », rappelle Brigitte Derbord. « Les négociants ont pu subsister pendant quelques années, mais les vignerons ont été remplacés par des paysans vendéens tournés vers la culture de céréales et l’élevage. »

L’influence des maisons sur la ville
La rétrospective s’intéresse aussi aux maisons elles-mêmes, avec l’exposition de bouteilles d’époque, de certificats et de dessins publicitaires qui plongent les spectateurs dans le monde des professionnels de l’époque. Le tout autour d’une pièce unique : un alambic miniature – mais parfaitement fonctionnel – fabriqué par les établissements Binaud, de Burie, et donné au musée par la famille du fondateur.
Enfin, l’équipe du musée a recréé un salon de négociant du XIXème siècle, tel qu’il pouvait y en avoir dans les maisons de maître qui ont fleuri dans la ville à cette époque et l’ornent encore aujourd’hui. L’occasion d’évoquer l’influence de ces familles sur la vie civique locale, comme le rôle d’Eugène Rogée-Fromy dans la fondation de la société d’archéologie locale. Ou encore de revenir sur l’histoire de la famille Richard, connue à travers Jacques, maire de 1971 à 1977, et qui eut plusieurs années durant un comptoir au Canada. « En 1912, Daniel Richard a sollicité son neveu, Émile, pour le seconder », raconte Brigitte Derbord. « Malheureusement, il est mort dans le naufrage du Titanic. » Car, comme le rappelle la documentaliste, « à St-Jean-d’Angély, la petite histoire rejoint souvent la grande… »